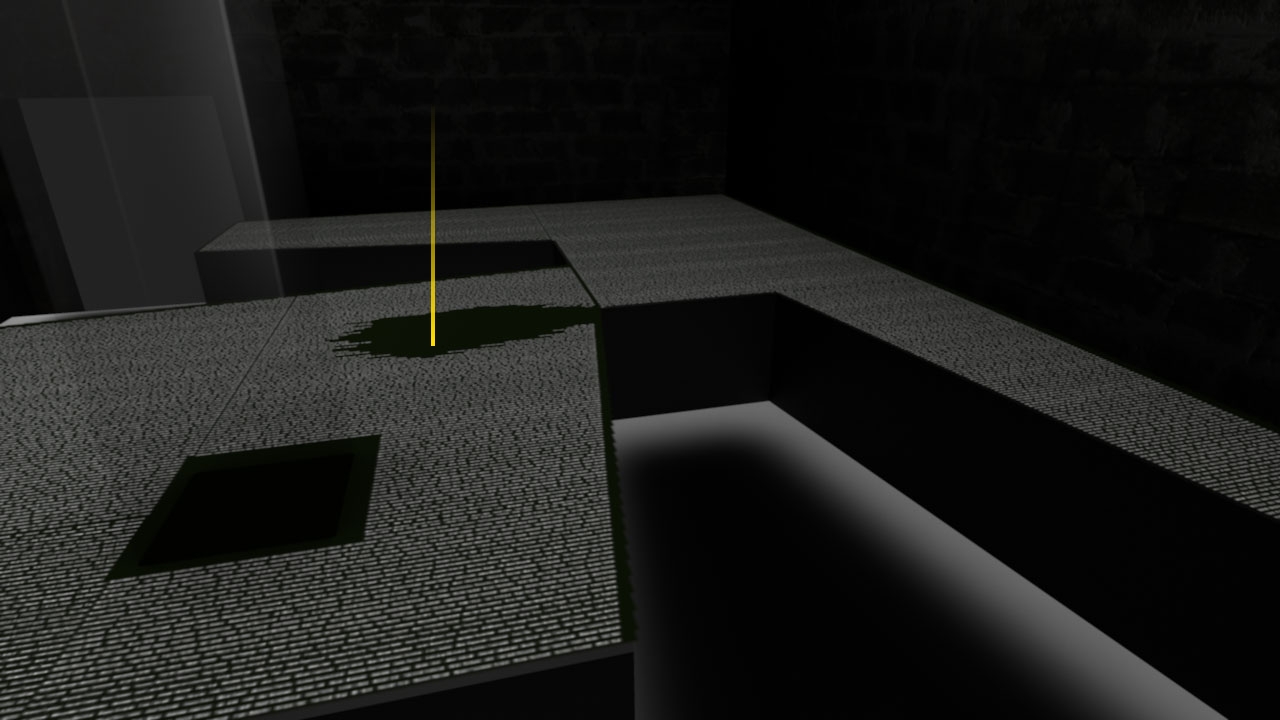Louis Leseigneur 1891 - 1945
Né(e) 8.1.1891 à Paris
Décédé(e) 10.3.1945 à Mauthausen
Biographie
Né à Paris en 1891, Louis Leseigneur suit des études primaires jusqu’en 1904 ou 1905. À cette époque, il entre en apprentissage dans la fabrique de pianos Herz et Cie où il fait le tour des différents services jusqu’à son appel sous les drapeaux en 1912. Incorporé au 115ème régiment d’infanterie en octobre, et une fois ses classes terminées, il reprend sa formation en fabrique de pianos. Lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale, il part avec son régiment en qualité d’infirmier avant d’être fait prisonnier lors de la retraite de Charleroi en août 1914. Il est rapatrié par la Suisse (service sanitaire) en 1915, année où il déplore la perte de son frère cadet tué aux Éparges (Meuse). Par la suite, il est affecté en Orient à une ambulance alpine où il reste environ 18 mois, avant d’être rapatrié en France, gravement malade après avoir contracté le paludisme. Après quelques mois de repos, il est de nouveau affecté à une ambulance chirurgicale du front et termine la guerre dans cette formation.
Démobilisé, il reprend son travail à la fabrique Herz avant de se marier le 4 octobre 1919 avec Marguerite Rollot. Deux filles naîtront de cette union : Annette le 19 mars 1921 et Lyse-Sylviane le 9 avril 1926. À cette même période, il achète à Soissons un fonds de facteur de pianos qu’il exploite par la suite sans interruption jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Vers 1930, il transfert le siège de son entreprise dans le centre de la ville, au 35 de la rue Saint-Martin où il réside à partir de cette date. Son commerce ne cessant de prospérer, Louis Leseigneur étend ses activités à tous les instruments de musique, à la TSF et enfin à la photographie. En 1939, il est de nouveau mobilisé comme secrétaire d’état-major à Laon où il reste jusqu’au début de l’année 1940, période de libération définitive de la classe 1911 à laquelle il appartient. Il rentre alors dans ses foyers et reprend son affaire. Cette reprise d’activité n’est que de courte durée puisqu’en mai 1940, il est contraint de quitter Soissons lors de l’invasion allemande. Il ne peut retourner chez lui qu’en juillet, pour constater de très gros dégâts matériels et il s’emploie alors à redresser son affaire, en faisant notamment de nombreux tirages photographiques pour les Allemands. Après la mort de son frère lors du Premier conflit mondial, sa famille est de nouveau éprouvée en juin 1940 lorsque son gendre, chef de service dans une usine soissonnaise et qui avait épousé sa fille aînée en janvier 1940, est tué sur le front.
Le 1er septembre 1940, il entre au réseau Hauet-Vildé rattaché au Musée de l’Homme dans le groupe de Soissons qui est en liaison avec celui de Paris. Au sein du réseau, il s’occupe à la fois de renseignements et de propagande, mais aussi de l’évasion de personnes menacées par les Allemands. Le 25 novembre 1941 au matin, il est arrêté à Soissons pour intelligence avec l’ennemi, en même temps que plusieurs dizaines de résistants de l’organisation de résistance à laquelle il appartient, à la suite des dénonciations de l’agent double Jacques Desoubrie. Après une instruction complètement secrète, le procès des 33 inculpés s’ouvre le 15 avril 1942 devant le Tribunal miliaire de Paris de la rue Boissy d’Anglas. Le verdict est rendu le 30 avril : six hommes sont condamnés à mort et fusillés le 27 octobre 1942, six autres condamnés à mort voyant leur exécution suspendue tandis que d’autres écopent de peine de réclusion à temps. Louis Leseigneur est condamné à 7 ans de réclusion pour intelligence avec l’ennemi. Il lui a été principalement reproché d’avoir participé à deux réunions de l’organisation, l’une en fin 1940 ou au début de 1941 dans son propre logement, l’autre, le 15 octobre 1941, chez le résistant Jean Vogel.
Les multiples interventions de sa femme, auprès du maréchal Pétain, de Fernand de Brinon (Ambassadeur de France, Délégué général du Gouvernement Français pour les Territoires occupés) resteront sans résultat et après confirmation du jugement, Louis Leseigneur est extrait de la prison de Fresnes et le 14 septembre 1942, dans le cadre de la procédure Nuit et Brouillard (« Nacht-und-Nebel »-Erlass), il embarque en gare de l’Est à Paris dans un train qui prend la direction de la prison de Karlsruhe où il est enregistré le lendemain. Le 22 septembre, il est transféré au Zuchthaus de Rheinbach et le 1er octobre à Sonnenburg. Le 14 novembre 1944, il arrive à Sachsenhausen comme la plupart des détenus de Sonnenburg et il se voit attribuer le matricule 117044. Dès le 26 novembre, il est envoyé au camp annexe d’Heinkel où les halls de fabrication abritent la production d’avions de guerre et où il occupe un poste de tôlier. Le 13 février 1945, il quitte Sachsenhausen avec le premier convoi d’évacués à prendre la direction de l’Autriche. Arrivé le 16 à Mauthausen, il échappe au massacre perpétré la première nuit suivant l’arrivée des nouveaux détenus. Immatriculé sous le numéro 131 376, Louis Leseigneur ne quittera pas le camp central. Malade, il meurt au Sanitätslager le 10 mars 1945.
Louis Leseigneur est titulaire de la Médaille des Alliés 1914-1918, de la Médaille de la Campagne d’Orient 1914-1918 et de la Croix de Guerre avec Palme à l’ordre de l’armée (14 janvier 1948). Il a obtenu la mention « Mort pour la France » et le titre de déporté résistant le 28 novembre 1951.
Adeline Lee
Sources :
SHD, dossier MED 21 P 476775 et 21 P 74865, LA 14385 (Extrait des registres de la prison de Fresnes), LA 19051 (Registres de la prison allemande de Rheinbach), MA 41/7, 12/3, SA 11/1, 26 P 1120 (rapport Kanthak).
Archives de l’Amicale de Mauthausen, pochette 451/3 : Convoi venant de Sachsenhausen par Juan de Diego (3ème secrétaire à la Schreibstube de mars 1941 à la libération) ; Archives Nationales, F/9/5577, audition de De Dionne par Mlle Chalufour (chargée de mission au Service de Recherche des Crimes de Guerre ennemis à Paris) le 11 août 1945.
Bibliographie :
Blance Julien, Au commencement de la Résistance. Du côté du musée de l’Homme, 1940-1941, Paris, Le Seuil, coll. « La Librairie du XXe siècle », 2010,pp. 285, 308.
Amicale d’Oranienburg-Sachsenhausen, Le mémorial des déportés français à Sachsenhausen, Amicale de Sachsenhausen, 2000, 387 p.
Amicale d’Oranienburg-Sachsenhausen, Sachso. Au cœur du système concentrationnaire nazi, Paris, Éditions de Minuit/Plon, coll. « Terre humaine poche », 2005 (1ère éd. 1989), 619 p.
Sitographie : http://www.museedelaresistanceenligne.org/
Emplacement dans la pièce des noms